Inhibition, symptôme et angoisse : Sigmund Freud
Inhibition, symptôme et angoisse
Tiré du livre Inhibition, symptôme et angoisse.

Sigmund Freud
Cette analyse approfondie explore les concepts fondamentaux de la psychanalyse freudienne, en examinant les relations entre inhibition, symptôme et angoisse. L'étude examine en détail les mécanismes de défense du moi contre les pulsions libidinales, le rôle du refoulement dans la génération des symptômes, et la fonction de l'angoisse en tant que signal de danger psychique.
Distinction entre inhibition et symptôme

L'inhibition affecte une fonction spécifique et n'est pas systématiquement pathologique. C'est une limitation normale d'une fonction, souvent temporaire et adaptative, qui survient à la suite d'un conflit psychique. L'inhibition implique de renoncer à certaines fonctions pour éviter un conflit avec le ça ou pour économiser l'énergie du moi.
Le symptôme, par contre, est un signe de processus pathologique. C'est la manifestation d'un conflit psychique non résolu qui se manifeste comme un compromis entre les pulsions et les défenses du moi.
Dans le langage clinique, on parle d’inhibition quand une fonction est simplement réduite, et de symptôme quand il y a un changement inhabituel ou une nouvelle façon de fonctionner. Cette différence est importante en pratique, car elle guide le thérapeute vers des approches différentes selon qu'il s'agit d'une inhibition ou d'un symptôme.
Fonction sexuelle
Souvent perturbatrice, en particulier avec l'impuissance et l'inhibition liée à la peur. L'inhibition sexuelle peut diminuer le désir ou provoquer des problèmes d'érection ou d'orgasme.
Cette fonction est très sensible selon Sigmund Freud aux conflits internes et aux peurs de castration.
Pour lui, il est possible que les symptômes se manifestent comme des troubles hystériques ou des rituels obsessionnels liés à la sexualité.
Alimentation
Souvent perturbée par manque d’appétit ou vomissements comme défense. Les inhibitions alimentaires se manifestent à cause de conflits oraux non résolus, alors que des symptômes tels que l'anorexie ou la boulimie démontrent des défenses plus complexes contre des pulsions refoulées. Les conflits psychiques précoces sont souvent exprimés par l'alimentation, qui est la fonction de base.
Locomotion

Peut être inhibée par rejet de la marche, faiblesse ou paralysie hystérique. Ces inhibitions peuvent exprimer une peur du déplacement, de l’autonomie ou de la séparation. Il peut arriver qu'elles montrent un évitement phobique, alors que les paralysies hystériques représentent un conflit refoulé lié au mouvement ou à l'agressivité.
L’arrêt de la marche peut également indiquer un retour à une phase de développement antérieure.. La locomotion peut être entravée par un refus de marcher, une faiblesse ou une paralysie d’origine hystérique.
Capacité de travail
Très vulnérable aux inhibitions, avec baisse de concentration, report des tâches ou fatigue excessive. L’inhibition du travail peut déplacer des conflits libidinaux ou agressifs vers l’activité professionnelle. Les symptômes peuvent inclure des vérifications compulsives ou une angoisse face aux tâches intellectuelles, révélant souvent des conflits d’ambition et de compétition.
Interprétation de l’inhibition
L’inhibition est une limite des fonctions du moi qui peut avoir plusieurs causes. Pour les inhibitions spécifiques, l’analyse révèle souvent un lien trop fort avec le plaisir dans les organes touchés.
- Abandon de la fonction :Le moi abandonne certaines fonctions pour éviter un conflit avec le ça ou le surmoi.
- Punition de soi : Certaines inhibitions servent à se punir soi-même, surtout dans le travail.
- Manque d'énergie : Le moi réduit son activité face à des tâches mentales difficiles.
En résumé, les inhibitions limitent les fonctions du moi, soit pour se protéger, soit par manque d’énergie psychique.
Nature du symptôme

Le symptôme est le signe qui remplace une satisfaction de pulsion qui n’a pas eu lieu. Il est le résultat du refoulement.
Le refoulement vient du moi qui refuse, parfois sur ordre du surmoi, d’accepter une pulsion venant du ça. L’idée porteuse du désir désagréable est alors empêchée d’atteindre la conscience.
En psychanalyse, le symptôme est donc un compromis entre le désir refoulé et les forces de défense. Il satisfait en partie la pulsion tout en respectant les défenses, ce qui explique pourquoi il est souvent contradictoire et difficile à changer.
Le symptôme prend des formes différentes selon la personne : problèmes physiques dans l’hystérie, pensées obsédantes dans la névrose obsessionnelle, ou évitement dans les phobies. Dans tous les cas, il remplace ce qui a été refoulé en utilisant l’énergie psychique détournée.
Contrairement à l’inhibition qui est une simple limitation du moi, le symptôme est une création nouvelle qui montre un processus actif. Il a un sens caché qui peut être découvert pendant la thérapie, révélant ainsi le conflit psychique sous-jacent.
Le symptôme persiste souvent car il apporte des avantages secondaires, comme l’attention des autres ou l’évitement de situations stressantes. Ces bénéfices rendent parfois difficile son abandon, même quand la personne en souffre consciemment.
Le mécanisme du refoulement

Le refoulement est le mécanisme de défense principal dans la théorie de Freud. C’est un processus où le moi écarte de la conscience les pensées, images et souvenirs liés à une pulsion jugée inacceptable. Ce processus s’effectue en plusieurs étapes qui interagissent entre elles.
Signal de déplaisir
Le moi émet un signal de déplaisir. Ce signal agit comme une alarme interne qui active les défenses face à un danger. Il se déclenche quand le moi reconnaît une pulsion menaçante.
Inhibition de la pulsion
La pulsion est bloquée ou détournée. Cette dernière étape permet de contrôler la pulsion dangereuse, soit en la bloquant, soit en la dirigeant vers des buts plus acceptables.
Retrait d’investissement
Le moi retire son énergie de la représentation pulsionnelle. Ce retrait affaiblit la représentation et l’empêche d’atteindre la conscience.
Production d’angoisse
L’énergie libérée crée l’angoisse comme signal d’alerte. Cette angoisse prépare le psychisme à affronter le danger, contrairement à l’angoisse qui submerge le moi.
Freud a changé sa théorie: l’angoisse n’est pas créée par la libido refoulée, mais existe déjà comme signal de danger qui cause le refoulement. Ce changement important, présenté dans “Inhibition, symptôme et angoisse” (1926), marque un tournant dans sa vision de l’angoisse.
Le refoulement n’est jamais totalement efficace. L’énergie refoulée cherche toujours des moyens détournés pour s’exprimer. Cette réapparition partielle explique les symptômes, les rêves, les lapsus et autres compromis. Le refoulement demande aussi beaucoup d’énergie psychique pour maintenir les représentations indésirables hors de la conscience, ce qui peut affaiblir le moi.

L’efficacité du refoulement varie selon les personnes et dépend de plusieurs facteurs, comme la force du moi par rapport au ça et au surmoi, et l’intensité des pulsions. Dans la thérapie analytique, comprendre ce mécanisme est essentiel pour aider le patient à lever ses refoulements et à intégrer ce qui était exclu de sa conscience.
L’origine de l’angoisse

Les états émotionnels font partie de notre vie psychique comme traces d’événements traumatiques du passé. La naissance, première expérience d’angoisse de chaque individu, donne ses caractéristiques à l’expression de l’angoisse. Cette “angoisse originaire” devient un modèle pour toutes les situations de danger que la personne rencontrera plus tard.
Freud a beaucoup changé sa théorie de l’angoisse au fil du temps. Dans sa première version, l’angoisse venait directement de la libido refoulée. Plus tard, il a vu l’angoisse comme un signal émis par le moi face à un danger, signal qui déclenche ensuite le refoulement.
Refoulement originaire
Premiers refoulements liés à des facteurs comme la force trop grande de l’excitation. Ces refoulements de base forment le noyau de l’inconscient et créent les premières fixations de la libido. Ils arrivent avant même que le moi soit complètement formé et établissent une première séparation entre conscient et inconscient.

Formation du surmoi
Marque possiblement la frontière entre refoulement originaire et refoulement après coup. L’intégration des interdits des parents et de la société crée cette instance qui devient une source d’angoisse morale. Le surmoi représente alors une menace interne qui peut créer l’angoisse de culpabilité quand nos désirs vont contre ses règles.
Refoulement après coup
Suppose des refoulements originaires qui attirent d’autres contenus. Ce mécanisme plus élaboré intervient quand le moi est assez développé pour reconnaître un danger venant des pulsions. Il agit sur des représentations liées aux contenus déjà refoulés et qui risquent de réveiller les désirs indésirables.
Angoisse comme signal
Dans sa théorie révisée, Freud explique que l’angoisse fonctionne comme un signal d’alarme du moi. Ce signal est une version affaiblie de l’angoisse originaire vécue lors de situations traumatiques passées. Il permet à l’individu d’activer ses défenses avant que la situation ne devienne réellement périlleuse.
Angoisse et castration
L’angoisse de castration est une étape clé dans le développement psychosexuel. Elle vient après l’angoisse de séparation et devient un moteur important du refoulement, particulièrement dans la résolution du complexe d’oedipe et la formation du surmoi.
Cette évolution dans la théorie de l’angoisse nous aide à comprendre comment les expériences de notre petite enfance façonnent notre façon de gérer les dangers psychiques et comment le refoulement est lié à nos réactions anxieuses face aux conflits internes.
Formation des symptômes dans les phobies

L’étude des phobies chez les enfants montre comment le psychisme crée des symptômes. Les phobies nous aident à comprendre comment notre esprit se défend contre l’angoisse. Le cas du petit Hans, étudié par Freud en 1909, est un exemple important : sa peur des chevaux remplaçait en fait son angoisse envers son père.
Cette phobie est apparue chez un garçon de cinq ans qui avait jusque-là une bonne relation avec son père. Le symptôme se manifestait par une peur intense des chevaux, surtout ceux qui étaient grands, avec un museau noir, ou qui faisaient certains mouvements comme tomber ou se cabrer.
Conflit d’ambivalence
La phobie se trouve un mélange de sentiments contradictoires : l’amour et l’hostilité envers le père existent en même temps, créant un conflit interne. Cette ambivalence est normale pendant la phase oedipienne, quand l’enfant doit gérer des sentiments complexes envers ses parents. Le petit Hans était jaloux de son père (qui rivalisait avec lui pour l’attention de sa mère), mais il l’aimait aussi et s’identifiait à lui.
Déplacement
Le déplacement est un mécanisme clé dans la formation de la phobie. L’hostilité envers le père, que l’enfant ne peut pas accepter, est transférée sur le cheval. Ce transfert permet d’éviter le conflit direct avec le père tout en exprimant indirectement les sentiments agressifs. Le choix du cheval n’est pas un hasard : certaines caractéristiques du père (force, autorité, grande taille) se retrouvent dans l’animal. Souvent, plusieurs éléments conflictuels sont combinés dans le symptôme phobique.
Angoisse de castration

La peur que le cheval ne morde ou ne tombe représente, selon la psychanalyse, la peur d’être “castré” par le père. Cette angoisse survient quand l’enfant imagine que ses désirs pour sa mère pourraient être punis par son père. Chez le petit Hans, cette crainte était renforcée par des expériences concrètes : avoir vu des chevaux tomber, avoir entendu des menaces (“si tu fais ça, le docteur te coupera le zizi”), et avoir remarqué les différences anatomiques entre filles et garçons. Cette angoisse de castration est le moteur principal de la phobie.
Contrairement à d’autres mécanismes névrotiques, l’angoisse dans la phobie n’est pas créée par le refoulement lui-même. Elle est plutôt une transformation de l’angoisse de castration, désormais dirigée vers un danger extérieur jugé réel. La personne évite alors l’angoisse non pas en réprimant ses pensées, mais en évitant simplement la situation ou l’objet qui lui fait peur.
Ce déplacement vers un objet externe offre certains avantages : il permet de mieux contrôler l’angoisse (on peut fuir ou éviter l’objet qui fait peur) tout en gardant refoulés les désirs Sdipiens sous-jacents. Mais cela a un coût : limitation de la liberté, appauvrissement des relations et persistance du conflit non résolu.
Guérir d’une phobie demande donc plus qu’une simple désensibilisation face à l’objet qui fait peur. Il faut aussi comprendre et résoudre le conflit psychique d’origine, permettant ainsi de dépasser progressivement le complexe d’Sdipe et d’intégrer les sentiments contradictoires dans une structure psychique plus mature.
Symptômes dans l’hystérie et la névrose obsessionnelle
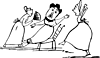
Hystérie de conversion
Symptômes comme paralysies, contractures ou douleurs, souvent sans angoisse apparente. Le cours d’excitation est inhibé ou dévié.
Névrose obsessionnelle
Symptômes de deux formes: interdictions/précautions et satisfactions substitutives.
Combat opiniâtre contre le refoulé.
Régression
Dans la névrose obsessionnelle, régression de l’organisation génitale à la phase sadique-anale, déterminante pour les symptômes.
La névrose obsessionnelle montre des mécanismes spécifiques comme l’annulation rétroactive et l’isolation, techniques qui renforcent le refoulement.
Techniques défensives spécifiques
Annulation rétroactive
Technique “magique” visant à effacer un événement lui-même, pas seulement ses conséquences.
Isolation
Séparer une impression de ses connexions affectives et associatives, créant une pause où rien ne peut arriver.
Tabou du toucher
Interdiction fondamentale dans la névrose obsessionnelle, liée à l’investissement tant agressif que tendre.
L’isolation est la suppression de la possibilité de contact, moyen de soustraire une chose à toute espèce de toucher. Le névrosé isole une impression pour empêcher les associations avec d’autres pensées.
Révision de la théorie de l’angoisse
Freud révise sa théorie antérieure selon laquelle l’angoisse serait produite par transformation de la libido refoulée. Dans les phobies, l’angoisse de castration est clairement le moteur du refoulement.
Nouvelle conception
L’angoisse précède et provoque le refoulement
Mécanisme défensif
Le moi utilise l’angoisse comme signal de danger
Complexe d’Œdipe
Chaque névrose a pour effet la destruction du complexe d’oedipe
Cette révision théorique soulève de nouvelles questions: comment le moi s’épargne-t-il l’angoisse dans l’hystérie et la névrose obsessionnelle?
L’angoisse de castration est-elle l’unique moteur du refoulement, notamment chez les femmes?

